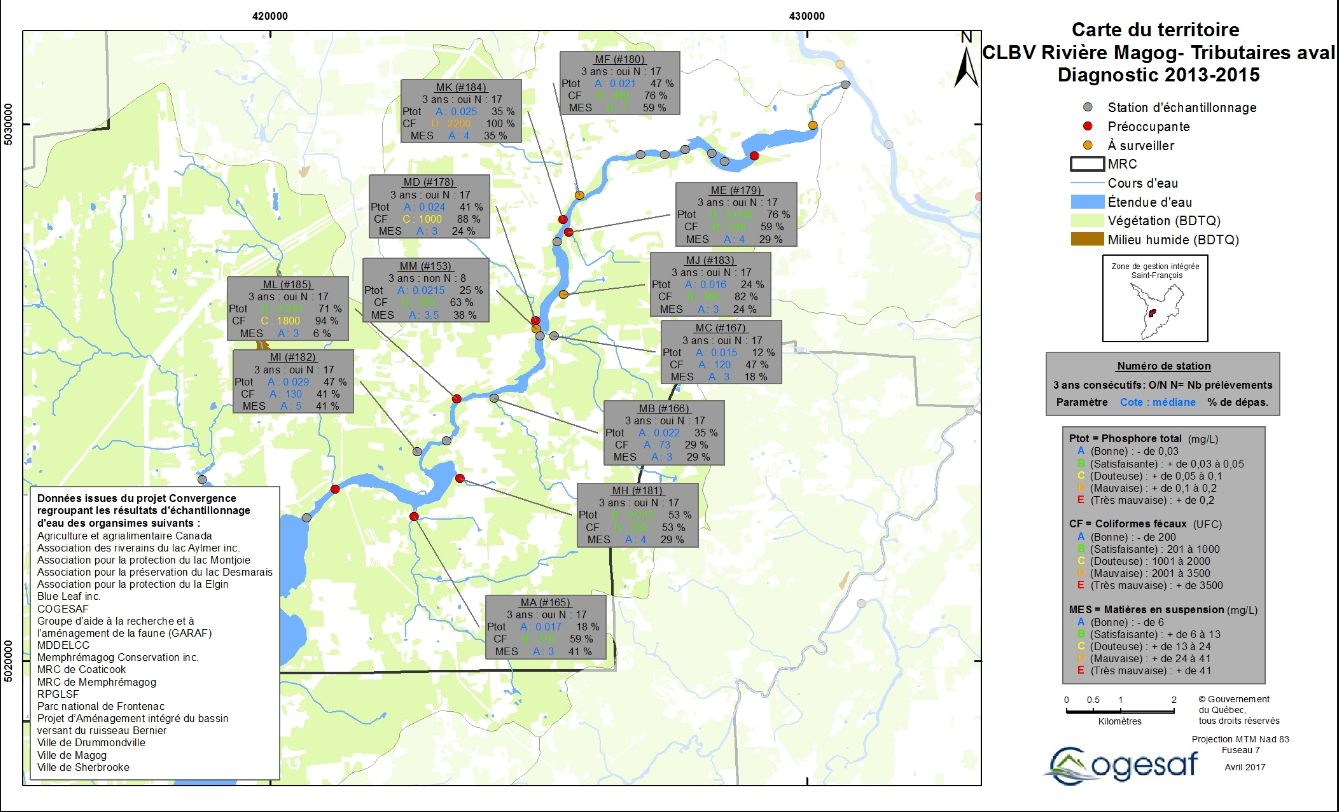La Magog : son potentiel hydraulique favorise l’industrialisation
Kesterman fait valoir que les pionniers américains qui commencèrent à s’établir à proximité de la Magog entre 1793 et 1812 furent fascinés par le courant et le débit de la rivière en toutes saisons[1]. Il rapporte également que durant tout le 19e siècle, le régime des eaux de la Magog fut perçu comme éminemment favorable aux activités industrielles, à cause, à la fois, de son débit abondant et de sa régularité. Ces qualités avaient, bien sûr, un rapport avec les lacs présents dans le bassin. Le Memphrémagog constituait un réservoir de près de 50 km, quasi inépuisable, et le lac Magog, un réservoir intermédiaire, capable de tempérer les éventuels écarts de débit entre Magog et Sherbrooke […][2].
Auclair et Laramée écrivent quant à eux que pour faciliter l’établissement d’immigrants britanniques dans les Cantons-de-l’Est, l’administration coloniale fonda à Londres une société foncière, la British American Land Company (BALC) […][3]. En fait, Kesterman précise qu’en 1834, le potentiel hydraulique élevé de la Magog poussa cette compagnie à en acheter les terrains riverains, du moins aux endroits propices au harnachement par des barrages. Il s’agissait soit d’acquisitions de terres de la Couronne, soit d’achats auprès de particuliers[4].
Kesterman rapporte le rôle-clé de la BALC en ces termes: La BALC géra la rivière Magog à sa guise pendant près de soixante-dix ans. Elle utilisa la rivière pour faire flotter les billots coupés sur ses terres dans le massif de l’Orford afin de les débiter à sa scierie de Sherbrooke. Elle harnacha les gorges de Sherbrooke d’une série de cinq barrages. Elle contrôla l’accès des manufacturiers à cette énergie. Jusqu’en 1870, les industriels qu’elle consentait à voir s’installer à Sherbrooke durent accepter le statut de locataires des terrains, des bâtiments et de l’énergie des barrages. Par la suite, la BALC se mit à vendre terrains, bâtiments et même certains de ses barrages, mais continua à contrôler les débits d’eau[5].
Caractérisée par l’installation de nombreuses petites et moyennes entreprises manufacturières qui tiraient parti de l’énergie des gorges de la rivière Magog, la période de 1834 à 1866 fut également marquée par l’innovation technologique des entrepreneurs sherbrookois et par la diversité des secteurs industriels qu’ils implantèrent : bois, cuir, laine, coton, papier, fer et mécanique[6]. Ajoutons que Kesterman fait valoir que pour Sherbrooke, la période qui s’étendit de 1866 à 1896, antérieure à l’utilisation de l’électricité à des fins d’énergie, marqua l’apogée d’un système manufacturier basé sur la force hydraulique. À l’époque, les gorges de la Magog étaient considérées comme un des meilleurs sites industriels du Québec, car les eaux de la rivière n’y gelaient jamais et les machines entraînées par l’énergie de ses barrages pouvaient donc tourner hiver comme été[7]. En 2004, Kesterman écrit enfin que quelques usines sont encore actives sur les rives de la Magog (C.S. Brooks, Eka Nobel, American Biltrite)[8] […].
[1] Kesterman, J.-P. Tout le long de la rivière Magog. Se promener du lac Memphrémagog à la Cité des rivières. Éditions Collection Patrimoine. 2004. p. 20
[2] Idem, p.16
[3]Auclair, M.-J., Laramée, P. Les cantons de l’Est. Paysages. Histoire. Attraits. Les Éditions de l’homme. 2007. p. 91
[4] Kesterman, J.-P. Tout le long de la rivière Magog. Se promener du lac Memphrémagog à la Cité des rivières. Éditions Collection Patrimoine. 2004. p. 21
[5] Idem. p. 21
[6] Kesterman, J.-P. Histoire de Sherbooke. Tome 1 : de l’âge de l’eau à l’ère de la vapeur (1802-1866) Éd. GGC. 2000. p. 161
[7] Kesterman, J.-P. Histoire de Sherbrooke. Tome 2. De l’äge de la vapeur à l’ère de l’électricité. (1867-1896) Éd. GGC 2001. p.16
[8] Kesterman, J.-P. Tout le long de la rivière Magog. Se promener du lac Memphrémagog à la Cité des rivières. Éditions Collection Patrimoine. 2004. p. 2